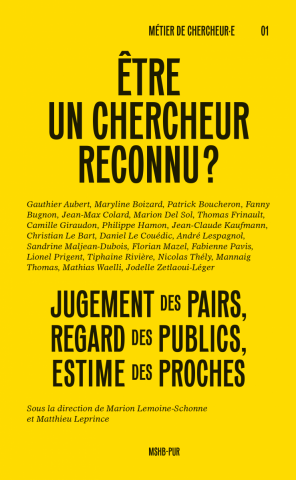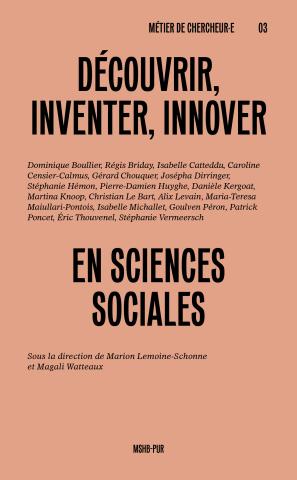L’édition en SHS a largement sous-estimé la question du métier de chercheur. Plus volontiers disposés à présenter les résultats de leurs recherches qu’à parler d’eux-mêmes, les chercheurs capitalisent pourtant des ressources qui incitent à la réflexivité quant à leurs propres pratiques et même, au-delà, quant à leur place dans la cité. L’objectif ici poursuivi est de publier une série de petits ouvrages visant, sur plusieurs années, à explorer les diverses facettes du métier de chercheur en SHS. L’écriture doit laisser une large place aux témoignages des intéressés, afin de parier sur la réflexivité des chercheurs. Plus précisément, il s’agit d’entrecroiser des témoignages réflexifs et des analyses plus surplombantes, pour donner à voir la façon dont le métier est vécu, approprié, décliné.
Ce projet, né en 2017 à la Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne, donne lieu à des journées d’étude pluridisciplinaires, lesquelles débouchent sur la publication d’ouvrages dans la série « Métier de chercheur·e », coéditée par la MSHB et les Presses universitaires de Rennes en version papier et en libre accès sur OpenEdition Books.
Consulter les ouvrages de la collection sur OpenEdition Books
Le premier ouvrage, paru en 2019, est consacré à la question de la reconnaissance et de la légitimité des chercheurs, interrogeant l’imbrication des formes plurielles de reconnaissance par les pairs, les institutions et les différents publics, ou encore les proches. Le deuxième ouvrage, paru en décembre 2021, porte sur la pratique partagée de l’écriture en sciences sociales. Le troisième ouvrage de la série est paru en octobre 2024. Il analyse la diversité des processus de découverte, d’invention et d’innovation en sciences humaines et sociales, à travers une exploration des définitions qu’en donnent différents chercheurs, dans un contexte d’incitation à l’interdisciplinarité et à l’innovation, de révolution numérique et d’urgence écologique.
Les porteurs des journées d'étude et de la série d’ouvrages sont Christian Le Bart, professeur de science politique à Sciences Po Rennes ; Marion Lemoine-Schonne, chargée de recherche au CNRS en droit international ; Matthieu Leprince, professeur d’économie à l’université de Bretagne occidentale ; et Florian Mazel, professeur d’histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Être un chercheur reconnu ?
Jugement des pairs, regard des publics,
estime des proches
Cette publication est le premier ouvrage de la série « Métier de chercheur·e ».
Sous la direction de Marion Lemoine-Schonne, CNRS (laboratoire IODE – CNRS/Université de Rennes 1) et Matthieu Leprince, université de Bretagne occidentale (laboratoire AMURE – CNRS/UBO/IFREMER). Date de parution : le 24 octobre 2019.
Présentation de l’ouvrage
Qu’est-ce qu’un chercheur reconnu ? Quels sont les leviers et les formes de la reconnaissance en sciences humaines et sociales ? En interrogeant la condition du chercheur dans son singulier métier, qu’il soit rattaché à un organisme de recherche ou enseignant-chercheur, l’ouvrage combine de manière originale des témoignages et des analyses, invitant à la réflexivité dans un monde professionnel où la question de la reconnaissance est souvent ignorée.
Au-delà de la reconnaissance par les pairs, injonction est faite aujourd’hui aux chercheurs de « valoriser » leurs travaux, de « médiatiser » leurs résultats, au risque de brouiller les frontières qui définissent l’activité scientifique. Volontairement ou non, certains chercheurs se trouvent ainsi confrontés à des formes plurielles, et parfois concurrentes, de reconnaissance, émanant soit des médias et des publics non académiques (voire du « grand public »), soit des institutions intéressées à la recherche et à sa diffusion.
La diversité et l’imbrication des cercles de reconnaissance sont interrogées dans cet ouvrage, depuis l’espace quasi domestique du chercheur devant rendre compte à ses proches de son métier, jusqu’à l’espace public le plus large, celui qui vaut à certains la visibilité médiatique et le statut d’« intellectuel ». De l’histoire à la gestion, des études littéraires au droit, les ressorts des gratifications (y compris narcissiques) liées à la reconnaissance diffèrent entre chercheurs et entre disciplines, tout comme les coûts d’une reconnaissance parfois plus ambivalente qu’il n’y paraît.
Avec les contributions de :
Gauthier Aubert, Maryline Boizard, Patrick Boucheron, Fanny Bugnon, Jean-Max Colard, Marion Del Sol, Thomas Frinault, Camille Giraudon, Philippe Hamon, Jean-Claude Kaufmann, Christian Le Bart, Daniel Le Couédic, André Lespagnol, Sandrine Maljean-Dubois, Florian Mazel, Fabienne Pavis, Lionel Prigent, Tiphaine Rivière, Nicolas Thély, Mannaig Thomas, Mathias Waelli, Jodelle Zetlaoui-Léger
Commander l’ouvrage sur le site des PUR
Ressources – vidéos
Grand témoin : Jean-Claude Kaufmann (24 novembre 2017)
Métier de chercheur·e – Reconnaissance et légitimité- Grand témoin : Patrick Boucheron (12 janvier 2018)
Métier de chercheur·e – Reconnaissance et légitimité
Téléchargement
Écrire les sciences sociales
Écrire en sciences sociales
Présentation de l’ouvrage
Thèses, articles, livres… tous les chercheurs en sciences humaines et sociales consacrent une partie de leur temps à écrire. Ce dénominateur commun masque à l’évidence une grande diversité quant aux pratiques d’écriture : écrire un manuel juridique n’est pas écrire un article dans une revue d’économie ; rédiger un rapport de recherche pour un organisme public n’est pas rédiger un essai pour un éditeur soucieux de toucher un lectorat aussi large que possible…
Malgré cette diversité, l’acte d’écriture demeure une pratique partagée. L’objectif de ce livre, qui entend croiser témoignages et analyses, est certes de donner à voir la diversité des pratiques d’écriture mais aussi et surtout de faire dialoguer les chercheurs autour des manières de mettre leur idéal scientifique à l’épreuve de l’écriture. Car écrire en sciences humaines et sociales, ce n’est jamais simplement rédiger, ce n’est jamais simplement consigner un résultat de recherche. L’écriture n’est ni simple, ni transparente, ni innocente. En invitant les chercheurs à dire leur rapport à l’écriture, et même à raconter leurs expériences (heureuses ou douloureuses), ce second volet de la collection « Métier de chercheur·e » entend interroger frontalement une pratique trop peu souvent mise en discussion dans l’espace académique.
Avec les contributions de :
Philippe Artières, Hélène Bailleul, Jean Boutier, Philippe Carrard, Benoît Feildel, Pierre-Henry Frangne, Christophe Gimbert, Caroline Guittet, Nathalie Heinich, Adeline Latimier, Marion Lemoine-Schonne, Matthieu Leprince, Annick Madec, Grégor Marchand, Fabien Moizeau, Caroline Muller, Erik Neveu, Séverine Nikel, Fanny Rinck, Laurent Rousvoal, Léa Sénégas, Jean-Yves Trépos, Sylvain Venayre, Jean-Manuel Warnet
Commander l’ouvrage sur le site des PUR
Ce deuxième ouvrage est, comme le premier, le fruit de deux journées d’étude du cycle pluriannuel « Métier de chercheur·e » organisées par et à la MSHB, en partenariat avec le pôle doctoral de Rennes, les 1er et 15 mars 2019.
Ressources – vidéos
Grand témoin : Philippe Artières (1er mars 2019)
Métier de chercheur·e – Écrire en sciences sociales, écrire les sciences sociales- Grand témoin : Nathalie Heinich (15 mars 2019)
Métier de chercheur·e – Écrire en sciences sociales, écrire les sciences sociales
Téléchargement
Découvrir, inventer et innover en sciences sociales
Le troisième ouvrage de la série « Métier de chercheur·e », paru le 24 octobre 2024, propose d’analyser de concert les sujets de la découverte, de l’invention et de l’innovation en SHS.
Sous la direction de Marion Lemoine-Schonne, CR CNRS en droit international (UMR 6262 IODE) et Magali Watteaux, MCF Rennes 2 en histoire et archéologie (UR Tempora et UMR 7041 ArScAn).
Présentation de l’ouvrage
Alors que les grandes découvertes scientifiques connues du grand public sont souvent issues des sciences exactes, l’enjeu de ce troisième volet de la série « Métier de chercheur·e » est de montrer en quoi consistent les découvertes, inventions et innovations en sciences humaines et sociales au travers de l’expérience des chercheurs. Qu’est-ce qu’inventer quand on est juriste ? Entre découverte et redécouverte, comment s’exerce le métier d’historien ? De quoi procèdent les innovations dans les disciplines d’observation de la société, quels en sont les freins ? L’ouvrage porte également sur les incitations croissantes à l’interdisciplinarité dans le rapport à la découverte ainsi que sur l’impact des nouvelles technologies et des appels récurrents à l’innovation – entrepreneuriale, technologique ou sociale – par les institutions pilotes de la recherche. Les questions sont riches et nombreuses, irriguant l’ensemble des contributions rassemblées.
En interrogeant la condition du chercheur dans son singulier métier, qu’il soit rattaché à un organisme de recherche ou enseignant-chercheur, qu’il soit jeune chercheur en formation ou au sommet de sa carrière, l’ouvrage combine de manière originale des témoignages et des analyses, invitant à la réflexivité sur ce sujet peu traité.
Avec les contributions de :
Dominique Boullier, Régis Briday, Isabelle Catteddu, Caroline Censier-Calmus, Gérard Chouquer, Josépha Dirringer, Stéphanie Hémon, Pierre-Damien Huyghe, Danièle Kergoat, Martina Knoop, Christian Le Bart, Alix Levain, Maria-Teresa Maiullari-Pontois, Isabelle Michallet, Goulven Péron, Patrick Poncet, Éric Thouvenel, Stéphanie Vermeersch
Ce troisième ouvrage est issu de deux journées d’étude du cycle pluriannuel « Métier de chercheur·e » organisées par et à la MSHB et qui se sont tenues les 10 et 11 février 2022.
Commander l’ouvrage sur le site des PUR
Ressources – vidéos
Grand témoin : Gérard Chouquer : Les paradoxes de la découverte en SHS, des territoires disciplinaires aux territoires de recherche (10 février 2022)
Métier de chercheur·e – Découvrir, inventer, innover en SHSMétier de chercheur·e – Découvrir, inventer, innover en SHS
Téléchargements